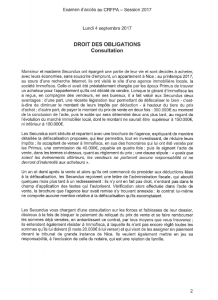Les étudiants inscrits à l’IEJ Jean Domat pour passer l’examen d’entrée aux CRFPA peuvent s’exercer en participant à plusieurs galops d’essai au cours du second semestre de l’année universitaire. Traditionnellement, la première série de galops est toujours basée sur les sujets de la précédente session de l’examen. Pour la première fois, l’IEJ publie en libre accès son corrigé de droit des obligations afin que des étudiants non inscrits à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne puissent en bénéficier.
Le sujet peut être téléchargé ci-dessous au format PDF, il correspond au sujet de droit des obligations de la session 2017 de l’examen. Ce sujet ayant été rédigé par la Commission nationale compétente, il était commun à tous les IEJ de France. Toutefois, le corrigé mis en ligne sur cette page n’est pas le corrigé national officiel. Il s’agit d’un corrigé détaillé rédigé par un membre de l’équipe pédagogique de l’IEJ Jean Domat dans le cadre du galop d’essai qui a eu lieu en janvier 2018.
Remarque liminaire
La plupart des questions soulevées par le sujet ne peuvent pas faire l’objet d’une réponse tranchée, soit parce que la question porte sur un point discuté du droit positif, soit parce que l’énoncé des faits est insuffisamment précis. Un tel sujet invite donc à évaluer la capacité des étudiants à envisager de multiples hypothèses et fondements : c’est la qualité de la démonstration dans la majeure et la mineure qui importe, plus que la conclusion retenue.
De ce fait, le présent corrigé se veut le plus exhaustif possible, mais il est évident qu’il était impossible d’envisager, en trois heures, la totalité des hypothèses et raisonnement traités ici. Certaines argumentations sont moins convaincantes que d’autres, certaines sont à la limite du programme de l’épreuve. Les copies qui les contiennent pouvaient être valorisées, mais les copies qui ne contenaient pas l’une des argumentations développées dans le présent corrigé n’étaient pas nécessairement sanctionnées si les raisonnements les plus pertinents figuraient par ailleurs dans le devoir.
Les copies qui ont envisagé les questions les plus importantes et qui ont développé des raisonnements pertinents sur les fondements textuels/jurisprudentiels les plus crédibles sont celles qui ont obtenu les meilleures notes. Quelques points ont pu être accordés lorsque l’étudiant envisageait des fondements probablement moins pertinents, mais qui ne pouvaient pas être totalement exclus (en raison de l’imprécision du sujet ou du droit positif) et qui figurent de ce fait dans le présent corrigé.
Le plan proposé ici n’est évidemment pas le seul possible. Les étudiants étaient très libres sur ce point dès lors que le devoir était construit de façon cohérente. Un plan de cas pratique peut être sanctionné dès lors qu’il entraîne de trop nombreuses redondances ou qu’il rend le propos confus, par exemple en mélangeant la question de la formation du contrat à la question de son exécution.
Idéalement, le devoir devait contenir un très bref résumé des faits en introduction, simplement pour « poser le décor » et annoncer le plan, et, éventuellement, une très brève synthèse (non présents dans ce corrigé).
Les articles cités sans mention de leur source sont des articles du Code civil. Sauf précision contraire, les arrêts cités sont tous mentionnés dans l’édition Dalloz 2018 du Code civil (ils le sont probablement également dans l’édition Litec).
Droit transitoire : l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que celle-ci entre en vigueur le 1er octobre 2016 (al. 1er) et que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne (al. 2). En outre, les lois nouvelles s’appliquent dès leur entrée en vigueur, sauf disposition contraire, aux effets futurs des situations non contractuelles en cours et, a fortiori, aux situations non contractuelles futures (art. 2 ; Cass. civ. 3e, 13 nov. 1984, no 83-14.566). En l’espèce, les faits sont postérieurs au 1er octobre 2016 et sont donc régis par les dispositions de l’ordonnance.
Les acquéreurs veulent obtenir « l’anéantissement » du contrat de vente, on envisagera donc la question de son invalidité (I). Ils veulent également résister à la société Immofisca, on envisagera donc la question de l’invalidité du contrat éventuellement conclu entre les acquéreurs et cette société (II). On envisagera enfin la responsabilité civile des vendeurs et de la société Immofisca (III).
I) L’invalidité du contrat de vente
Nous développerons les causes de nullité envisageables (A) puis les conséquences de la nullité (B).
A) Les causes de nullité
On peut, en l’espèce, envisager une nullité pour vice du consentement (1), pour non-déterminabilité du prix de vente (2) et en raison du conflit d’intérêts du mandataire (3).
1) Les vices du consentement
Notons à titre liminaire que la violation d’une obligation d’information précontractuelle n’est pas, à elle seule, une cause de nullité (art. 1112-1, al. 6, du Code civil). Cette question sera donc traitée ultérieurement, lorsque sera envisagée la question de la responsabilité civile.
En l’espèce, la défiscalisation que l’agence a fait miroiter aux acquéreurs s’avère impossible. Cela est potentiellement constitutif d’une erreur de droit (a) ou d’un dol (b).
a) L’erreur de droit
L’erreur doit être déterminante du consentement, c’est-à-dire qu’elle doit être de « telle nature que, sans [elle], l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » (art. 1130, al. 1er), ce qui s’apprécie in concreto (ibid., al. 2). En l’espèce, on peut penser que les acquéreurs parviendront à prouver le caractère déterminant de l’erreur, notamment en s’appuyant sur la brochure d’information de l’agence immobilière annexée au contrat de vente et sur le fait que le montant déductible des impôts était équivalent à un tiers du prix de vente de l’immeuble (Cass. civ. 1re, 8 mars 2012, no 10-21.239 : en l’espèce les juges du fond ont « souverainement estimé que l’information donnée à Mme X… relativement au crédit d’impôt afférent à la réalisation des travaux litigieux, lequel avait été évalué par la société à la somme de 7 250,21 euros représentant plus du tiers du montant de ceux-ci, avait déterminé le consentement de l’intéressée […] » ; cet arrêt n’est pas cité dans l’édition Dalloz du Code civil).
L’erreur doit être excusable (art. 1132). La maxime « nul n’est censé ignorer la loi » signifie uniquement que l’ignorance d’une norme n’est pas un motif qui permet d’échapper à son application ; elle ne conduit donc aucunement à rendre inexcusable toute erreur de droit (l’article 1132 envisageant expressément la possibilité d’une nullité pour erreur de droit). En l’espèce, les acquéreurs sont des particuliers, ils ne semblent avoir aucune qualification professionnelle qui justifierait qu’ils aient des connaissances poussées en matière de fiscalité, ils n’avaient donc aucune raison de mettre en doute la véracité des informations transmises par le gérant de l’agence immobilière. L’erreur est donc excusable.
L’erreur doit porter sur « les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » (art. 1132). Les « prestations » d’un contrat de vente sont deux transferts de propriété réciproques : une somme d’argent contre un bien d’une autre nature. La Cour de cassation juge que l’erreur sur les possibilités de défiscalisation est une erreur sur les motifs et non une erreur sur les qualités essentielles de la prestation (Cass. civ. 1re, 13 févr. 2001, no 98-15.092 ; Cass. civ. 3e, 24 avr. 2003, no 01-17.458). L’erreur sur les motifs « n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement » (art. 1135, al. 1er). Selon Gaël Chantepie et Mathias Latina, cette disposition consacre la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « l’erreur sur un motif du contrat […] n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat » (V. les deux arrêts précités et Cass. com., 30 mai 2006, no 04-15.356 ; 11 avr. 2012, no 11-15.429 ; G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Dalloz, 2006, no 316), mais on peut toutefois remarquer que l’article 1135, alinéa 1er, n’emploie pas le terme « stipulation ». En l’espèce, « le contrat lui-même ne comporte aucune mention relative à la défiscalisation ». On ne peut raisonnablement pas qualifier la brochure annexée de « stipulation expresse » (formule jurisprudentielle antérieure à la réforme de 2016), la brochure n’étant pas une stipulation. On pourrait arguer que le fait d’annexer au contrat de vente la brochure d’information « expliquant de manière détaillée la défiscalisation proposée » suffit à en faire « expressément un élément déterminant » du consentement (formule du nouvel article 1135, al. 1er), mais c’est cette fois le caractère exprès qui semble douteux. Si le fait d’annexer la brochure au contrat manifeste l’intention des parties de faire de la défiscalisation un élément déterminant de leur consentement, c’est plutôt de manière implicite, faute de stipulation en ce sens. Il semble donc difficile d’invoquer une nullité pour erreur en l’espèce. [Comme précisé en introduction, la conclusion retenue importe peu ici, car la solution est incertaine en l’état du droit positif. C’est avant tout la qualité du raisonnement développé qui détermine l’attribution des points.]
b) Le dol
Nous avons établi dans la partie précédente que l’erreur des acquéreurs portait vraisemblablement sur un motif du contrat, mais cela n’est pas un obstacle à l’action en nullité lorsque cette erreur a été provoquée par un dol : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. » (art. 1139.)
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » (art. 1137, al. 1er.) « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. » (art. 1138.) En l’espèce, il est possible que la société Immofisca représentait, en tant que mandataire, les vendeurs lors de la signature du contrat de vente. Mais il est aussi fréquent, en matière immobilière, que le contrat de vente soit conclu directement par les vendeurs, l’agent immobilier se contentant alors seulement de mettre en relation les vendeurs et les acquéreurs. Bien que l’on parle alors parfois en pratique, dans cette hypothèse, de « mandat de recherche », il n’y a en réalité aucune représentation juridique dès lors que l’agent immobilier n’a pas le pouvoir d’engager les vendeurs, le terme « mandat » est donc ici galvaudé.
Il reste à déterminer si le vendeur et/ou son potentiel représentant savaient que la défiscalisation était impossible :
- Si l’agent immobilier le savait, il est l’auteur de mensonges qui ne sont constitutifs d’un dol que s’il était le représentant des vendeurs ou qu’il était de connivence avec eux (art. 1137, al. 1er ; 1138) ;
- Si les vendeurs le savaient, mais pas l’agent immobilier, ils ont commis une réticence dolosive puisqu’ils étaient présents lors du premier rendez-vous au cours duquel l’agent immobilier a transmis des informations fiscales erronées aux acquéreurs (art. 1137, al. 2 : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »).
Le dol, pour être une cause de nullité du contrat, doit également être déterminant du consentement (art. 1130), mais cette condition a déjà été vérifiée dans la partie précédente relative à l’erreur.
L’énoncé ne permet pas de savoir si l’agent immobilier et les vendeurs étaient de bonne foi, les étudiants ne pouvaient donc pas trancher cette question. Ils pouvaient en revanche préciser que le dol, étant une faute délictuelle et donc un fait juridique, se prouve par tout moyen.
2) Le contenu du contrat : la non-déterminabilité du prix
[L’invalidité éventuelle de la clause exclusive de réparation n’entraînerait pas la nullité du contrat puisque seule la clause invalide serait réputée non écrite, la question sera donc examinée en même temps que la question de la responsabilité, mais les étudiants pouvaient l’envisager en même temps que la question de la validité du contrat.]
Le prix est payable en deux fois : 300 000€ au moment de la conclusion du contrat de vente, puis le solde « qui sera déterminé deux ans plus tard, au regard de l’évolution du marché immobilier local, dont le montant ne saurait être supérieur à 150 000€, ni inférieur à 100 000€ ».
L’article 1163 érige en condition de validité du contrat le caractère « déterminé ou déterminable » de la prestation objet de chaque obligation. Son alinéa 3 précise que « la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
En l’espèce, une vague référence à « l’évolution du marché immobilier local » ne semble pas permettre de déterminer le prix sans un nouvel accord des parties. Le fait d’avoir prévu un plancher (100 000€) et un plafond (150 000€) au solde du prix ne devrait pas affecter sa déterminabilité. Il a pu être jugé que le contrat de vente qui prévoyait la fixation du prix « en prenant comme base les différentes cotations et le marché physique, à l’intérieur d’une fourchette fixant un prix minimum et un prix plafond » contenait un prix déterminable, mais en l’espèce il s’agissait du marché des pommes de terre qui fait l’objet de cotations officielles (Cass. civ. 1re, 14 déc. 2004, no 01-17.063). Le marché immobilier ne fait pas l’objet de cotations officielles, la détermination de la valeur d’un bien y est donc plus subjective. Dans un sens opposé, il a pu être jugé que le contrat de cession de parts sociales qui stipulait que « le prix sera fonction de l’évolution des résultats et de la valeur réelle de l’entreprise au moment de chaque transaction » contenait un critère objectif de détermination du prix (Cass. com., 10 mars 1998, no 96-10.168). [Les arrêts de 2004 et 1998 cités sont à la frontière avec le droit des contrats spéciaux et ne sont donc pas attendus dans les devoirs. La solution qui serait retenue par un juge est en l’espèce très incertaine, d’autant plus que la Cour de cassation, dans les deux arrêts précités, opère un contrôle normatif léger, ce qui signifie que les juges du fond disposent d’une certaine marge d’appréciation quant au caractère déterminable du prix. Les copies qui contiennent une argumentation pertinente doivent donc être valorisées, quelle que soit la conclusion retenue.]
L’article 1164, qui prévoit la possibilité de conférer à une partie le pouvoir de déterminer unilatéralement le prix, ne s’applique qu’aux contrats cadre et n’était donc pas applicable en l’espèce. Au demeurant, il n’était pas mentionné dans l’énoncé que la fixation du prix avait été confiée aux vendeurs.
L’article 1165, qui prévoit que le créancier peut fixer le prix après l’exécution de la prestation lorsque celui-ci n’a pas été déterminé auparavant d’un commun accord, ne s’applique qu’aux contrats de prestation de service et n’était donc également pas applicable en l’espèce, s’agissant d’un contrat de vente.
3) Le conflit d’intérêts du mandataire
« Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié. » (art. 1161.) Cette disposition est-elle applicable en l’espèce ? Il existe deux raisons d’en douter.
D’abord, il est précisé dans le sujet que les époux Secundus « signent l’acte de vente ». Il n’y a donc ici eu aucune représentation des acquéreurs au sens de l’article 1161 du Code civil. L’agent immobilier a peut-être conclu le contrat de vente au nom et pour le compte des vendeurs, mais il ressort du sujet qu’il n’a pas représenté juridiquement les acquéreurs puisque ceux-ci ont signé eux-mêmes le contrat de vente, ils ont personnellement exprimé leurs consentements à la vente. L’article 1161 du Code civil n’est donc pas applicable.
Ensuite, même en supposant qu’il y ait véritablement eu une double représentation, l’article 1161 est supplétif de volonté puisqu’il dispose en son second alinéa que le représenté peut autoriser le représentant à agir également au nom et pour le compte du cocontractant. Or en l’espèce les acquéreurs ne pouvaient ignorer que l’agent immobilier représentait les vendeurs, ils ont donc conclu un contrat de mandat en connaissance de cause, ce qui peut être analysé en une forme d’autorisation tacite. Dans cette hypothèse, les parties lésées par le conflit d’intérêts seraient en réalité les vendeurs, qui ignoraient que l’agent immobilier avait conclu un second contrat de mandat avec les acquéreurs. Or la nullité de l’article 1161 étant vraisemblablement relative, elle ne pourrait pas être invoquée par les acquéreurs dans ce cas de figure (l’article 1161 protège un intérêt privé, celui du représenté qui n’a pas autorisé le cumul des représentations, la nullité est donc relative selon l’article 1179 ; en ce sens : G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Dalloz, 2006, no 398).
B) Les conséquences de l’action en nullité
L’erreur et le dol sont des causes de nullité relative du contrat (art. 1131), de même que la non-déterminabilité du prix (art. 1178, al. 1er ; 1179, al. 1er). Si au moins l’une de ces causes de nullité est présente en l’espèce, les acquéreurs peuvent « bloquer le paiement du reliquat du prix de vente » : s’ils sont assignés en paiement par les vendeurs, ils n’auront qu’à exciper de la nullité du contrat.
On leur conseillera même de ne pas attendre une telle action et d’agir eux-mêmes en nullité, puisqu’ils souhaitent « se faire rembourser les sommes déjà versées ». En effet, « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 » (art. 1178, al. 2 et 3). Les vendeurs recouvreront donc la propriété de l’immeuble et devront restituer aux acquéreurs les 300 000€ déjà versés.
II) Le sort de la commission de 40 000€ due à Immofisca
Si l’on considère que le paiement d’une commission de 40 000 euros par les acquéreurs implique l’existence d’un contrat entre les acquéreurs et l’agent immobilier, on peut alors envisager la nullité de ce contrat pour erreur ou dol, dans les conditions énoncées précédemment (I/A/1/ et 3/, le raisonnement est identique, un renvoi suffit donc). La nullité entraîne alors une restitution des 20 000€ déjà versés.
Certains étudiants, lors de l’examen, sont allés plus loin en qualifiant le contrat conclu entre les acquéreurs et l’agent immobilier et le contrat de vente conclu entre les acquéreurs et les vendeurs d’ensemble contractuel indivisible, afin d’obtenir la caducité du contrat conclu avec l’agent immobilier à la suite de la nullité du contrat de vente (dans l’hypothèse où la nullité du contrat conclu avec l’agent immobilier ne pourrait être obtenue). Aucun arrêt de la Cour de cassation n’a retenu la qualification d’ensemble contractuel indivisible dans un tel cas de figure (la jurisprudence porte essentiellement sur les opérations de crédit-bail, sur des ensembles contractuels incluant un contrat de vente et un contrat de prêt et sur des ensembles incluant un contrat de vente ou de location et un contrat de maintenance du matériel vendu/loué). Le nouvel article 1186 dispose que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». Le champ d’application de cet article est potentiellement très vaste et est très discuté par la doctrine, il dépendra de l’interprétation que la jurisprudence fera de l’article. On pourrait donc considérer, même si une telle interprétation semble audacieuse, que l’exécution du contrat de vente était une « condition déterminante du consentement » des acquéreurs au contrat conclu avec l’agent immobilier, qui prévoyait le versement d’une commission de 40 000€. L’article 1186, alinéa 3, ajoute que « la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ». Il ne fait aucun doute, en l’espèce, que l’agent immobilier connaissait l’opération d’ensemble.
« La caducité met fin au contrat. » (art. 1187, al. 1er.) Le contrat conclu entre les acquéreurs et l’agent immobilier a déjà été partiellement exécuté. Toutefois, la Cour de cassation a déjà jugé que la caducité produit un effet rétroactif dans un ensemble contractuel indivisible (Cass. com., 5 juin 2007, no 04-20.380 ; en l’espèce la Cour de cassation a jugé que la caducité d’un contrat de vente déjà exécuté devait entraîner des restitutions réciproques du prix de vente et de la chose vendue). Le maintien de cette solution est discuté. La lettre de l’article 1187, alinéa 2, permettrait le maintien de cette solution, puisque l’article dispose que la caducité « peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». La caducité du contrat conclu avec l’agent immobilier permettrait alors aux acquéreurs d’être libérés de leur obligation envers l’agent immobilier et d’obtenir restitution des 20 000€ déjà versés.
[Les chances de succès d’une action fondée sur l’article 1186 étant plus qu’incertaines en l’espèce, les étudiants qui n’ont pas envisagé la qualification d’ensemble contractuel indivisible ne perdaient aucun point. Les copies ayant envisagé cette qualification pouvaient être valorisées si le raisonnement était suffisamment subtil (sans devoir être, toutefois, aussi précis que le corrigé) et non péremptoire.]
Toutefois, on pouvait également considérer qu’il n’y avait pas de contrat, en l’espèce, entre les acquéreurs et l’agent immobilier. En effet, « l’article 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 impose […] à l’agent immobilier et à son mandant de déterminer avec précision l’identité de la personne qui devra verser la rémunération due à l’agent : il peut ainsi s’agir soit du mandant lui-même, soit (cas le plus fréquent, en pratique) du cocontractant [c’est-à-dire l’acquéreur]. Le choix du débiteur procède de la liberté des parties » (Répertoire de droit immobilier, Dalloz, vo « Agent immobilier » par E. Cruvelier, janv. 2017, no 166). On pouvait ainsi considérer que le versement d’une commission était une obligation qui découlait du contrat conclu entre les vendeurs et l’agent immobilier et que le paiement de cette obligation avait été mis en partie à la charge des acquéreurs par le contrat de vente. Sur le fondement du droit commun il était donc possible de qualifier la situation de paiement de la dette d’autrui : les acquéreurs acceptent de payer une partie (40 000 euros) de la dette de commission des vendeurs, un tel paiement de la dette d’autrui ne crée pas de contrat entre les acquéreurs (tiers solvens) et l’agent immobilier (créancier accipiens). Un tel raisonnement est défendable en se fondant exclusivement sur le droit commun des contrats, dans la mesure où l’étudiant n’est pas supposé mobiliser des connaissances relevant du droit immobilier (le mandat de l’agent immobilier fait en effet l’objet d’une réglementation spéciale).
Dans cette hypothèse, l’annulation du contrat de vente entraînerait l’annulation rétroactive de l’obligation, pour les acquéreurs, de payer une partie (40 000€) de la commission à l’agent immobilier. Les acquéreurs ne seraient ainsi plus tenus de verser les 20 000€ restants et on pouvait même envisager une action en répétition de l’indu contre l’agent immobilier pour les 20 000€ déjà versés (art. 1302-2, al. 1er) ou contre les vendeurs (art. 1302-2, al. 2).
III) La responsabilité civile
Nous envisagerons d’abord les conditions de la responsabilité des vendeurs (A) et de la responsabilité de la société Immofisca (B). Nous envisagerons ensuite l’étendue des préjudices réparables et l’obligation à la dette des deux responsables potentiels (C).
A) La responsabilité des vendeurs
On peut observer que le sujet précise que les acquéreurs souhaitent obtenir « l’anéantissement » du contrat, « bloquer le paiement du reliquat du prix de vente » et « se faire rembourser des sommes déjà versées ». Les étudiants étaient donc fortement invités par le sujet à envisager la nullité du contrat. Il ne faut toutefois pas oublier que la responsabilité des vendeurs permettrait aux acquéreurs d’opposer aux vendeurs la compensation de leur créance de dommages-intérêts avec leur dette du prix de vente et ainsi, indirectement, de bloquer totalement ou partiellement le paiement du reliquat du prix de vente dans l’hypothèse où le contrat de vente ne serait pas nul (puisque nous avons vu dans le I que la nullité du contrat de vente était incertaine).
En l’espèce, il semble peu probable que la responsabilité contractuelle des vendeurs puisse être engagée, puisqu’aucune inexécution contractuelle ne semble pouvoir être caractérisée :
- Quand bien même la brochure d’information annexée au contrat de vente aurait-elle une valeur contractuelle, elle ne créerait probablement aucune obligation contractuelle en l’espèce, à moins que l’on considère que les vendeurs se soient obligés à garantir le résultat de l’opération de défiscalisation, mais il semble très incertain que l’on puisse déduire une telle garantie du seul fait d’annexer au contrat de vente la brochure d’information (il n’existe, à notre connaissance, aucun arrêt ayant retenu une obligation de garantie dans un tel cas de figure).
- Si l’on pouvait antérieurement douter de la nature de l’obligation précontractuelle d’information (plusieurs arrêts relatifs à cette obligation visaient les articles 1134, al. 3, 1135 et 1147), la doctrine majoritaire considère que la violation de l’obligation précontractuelle d’information du nouvel article 1112-1 du Code civil entraîne une responsabilité de nature délictuelle (G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Dalloz, 2006, no 189 ; N. Dissaux et Ch. Jamin, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Commentaire des articles 1100 à 1386-1 du Code civil, Dalloz, 2016, p. 19 ; contra : M. Mignot, « Commentaire article par article de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (II) », LPA 7 mars 2016, no 47, p. 7 et s.).
- Le dol a toujours entraîné la responsabilité délictuelle de son auteur.
S’il ne semble pas y avoir de responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle des vendeurs peut en revanche être envisagée (1), il faudra alors s’interroger sur les conséquences de la clause limitative de réparation en matière délictuelle (2).
1) Les conditions de la responsabilité délictuelle des vendeurs
Les vendeurs ont-ils violé l’obligation précontractuelle d’information de l’article 1112-1 ?
Selon l’article 1112-1, alinéa 1er : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Ce texte n’envisage pas l’hypothèse dans laquelle le contrat est conclu par un mandataire et où des informations erronées sont transmises par ce dernier. En outre, le texte limite l’obligation d’information à l’hypothèse dans laquelle la partie connaissait une information déterminante pour le consentement de l’autre ; aucune obligation d’information ne semble donc peser, du moins sur le fondement du droit commun postérieur au 1er octobre 2016, sur la partie qui ne connaissait pas une information mais qui aurait dû la connaître, par exemple en raison de sa qualité de professionnel (G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Dalloz, 2006, no 186).
En l’espèce, il fait peu de doute que les vendeurs (présents lors du premier rendez-vous avec les acquéreurs) et l’agent immobilier connaissaient le caractère déterminant de l’information pour les acquéreurs, mais cela ne suffit pas (V. supra, I/A/1/a/). Il faut également prouver qu’ils connaissaient le véritable état de la législation fiscale. À défaut, l’article 1112-1, si on en fait une application littérale, ne permet pas de reprocher à une partie (ou à son représentant) de ne pas avoir transmis une information qu’elle ignorait.
L’article 1112-1 du Code civil, si ses conditions sont réunies, permet d’engager la responsabilité civile délictuelle du débiteur de l’obligation d’information inexécutée (al. 6 et, à propos de la nature de la responsabilité, V. supra, III/A/).
Par ailleurs, si le dol des vendeurs est établi (V. supra, I/A/1/b), le dol est constitutif d’une faute civile et est donc de nature à engager la responsabilité délictuelle des vendeurs sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Cass. com., 15 janv. 2002, no 99-18.774 ; les arrêts en ce sens sont nombreux).
Enfin, il est également possible de valoriser les étudiants qui auraient considéré qu’une personne normalement prudente et diligente (une personne « raisonnable ») ne transmet pas des informations fiscales erronées et que la transmission d’informations fiscales erronées est par conséquent constitutive d’un manquement au devoir général de prudence et de diligence et, ipso facto, d’une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil.
La question de la validité de la clause limitative de réparation se pose alors.
2) L’incidence de la clause élusive de responsabilité
La doctrine considère très majoritairement que, en l’état du droit positif, les clauses limitatives de réparation ne sont pas valables en matière délictuelle (plusieurs arrêts anciens sont cités en ce sens, par exemple, très clairement, V. Cass. civ. 2e, 28 nov. 1962).
En ce qui concerne une éventuelle responsabilité délictuelle fondée sur la violation de l’obligation précontractuelle d’information, l’article 1112-1, alinéa 5, dispose par ailleurs que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ». En l’espèce, la clause prévoit que « les vendeurs ne porteront aucune responsabilité ni ne devront aucune indemnité aux acheteurs ». Si la clause s’attache formellement à supprimer les conséquences de la violation de l’obligation (la responsabilité et les dommages-intérêts) et non l’obligation elle-même, on peut considérer qu’il revient au même d’évincer l’obligation précontractuelle d’information ou d’évincer totalement la responsabilité qui découle de sa violation.
Si l’action en nullité du contrat de vente est accueillie favorablement, elle entraînera l’anéantissement de la clause limitative de réparation qui ne sera donc plus applicable.
Selon l’article 1170, « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». En l’espèce la responsabilité des vendeurs ne découlait pas de l’inexécution d’une obligation du contrat, un tel raisonnement est donc peu pertinent.
Selon l’article 1171, « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Le fait d’évincer toute responsabilité des vendeurs crée indubitablement un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. C’est cependant la qualification de contrat d’adhésion qui est très incertaine en l’espèce. En effet, la définition du contrat d’adhésion est l’un des points très discutés de la réforme. Selon l’article 1110 : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. » La notion de « conditions générales », notamment, est très discutée.
B) La responsabilité de l’agent immobilier (société Immofisca)
Il est précisé dans le sujet que les acquéreurs veulent engager la responsabilité de l’agent immobilier.
Le conflit d’intérêts ne semble pas constituer à lui seul un fait générateur de responsabilité pour les raisons évoquées précédemment : les acquéreurs savaient, quand ils ont contracté avec l’agent immobilier, que celui-ci représentait déjà les vendeurs (V. supra, I/A/3/).
Les fautes commises par un représentant lors de la conclusion d’un contrat au nom et pour le compte du représenté engagent la responsabilité délictuelle du représentant vis-à-vis du tiers (Cass. com., 30 janv. 1990, no 88-16.563 ; Cass. civ. 1re, 5 oct. 1994, no 92-10.963 ; ces arrêts ne figurent pas dans le code Dalloz).
Les acquéreurs peuvent donc invoquer plusieurs faits générateurs de responsabilité et il est probable qu’au moins l’un d’entre eux sera retenu par la juridiction saisie :
- Si l’élément intentionnel est établi, alors l’agent immobilier s’est rendu complice d’un dol (dans le cadre du contrat de vente, V. supra, I/A/1/b/), voire est l’auteur direct d’un dol (dans le cadre de l’éventuel contrat qu’il a conclu en son nom avec les acquéreurs, si l’on considère que ce contrat existe, V. supra, II) ce qui est constitutif d’une faute délictuelle (art. 1240).
- À défaut, on peut considérer qu’un « bon professionnel », c’est-à-dire un agent immobilier normalement prudent et diligent, ne donne pas des informations fiscales erronées aux acquéreurs qu’il démarche et que cela est par conséquent constitutif d’un manquement au devoir général de prudence et de diligence, donc d’une faute délictuelle (art. 1240).
- Si l’on considère qu’un contrat a été conclu entre les acquéreurs et l’agent immobilier (V. supra, II), on peut raisonnablement considérer que ce contrat crée à la charge de l’agent immobilier l’obligation d’accompagner le client dans la conclusion du contrat de vente et, à tout le moins, l’obligation de ne pas lui délivrer des informations juridiques erronées quant à la vente [en réalité, ce contrat crée une obligation de conseil à la charge de l’agent immobilier, mais on pourrait considérer qu’il s’agit de droit des contrats spéciaux, on est donc à la limite du programme de l’épreuve]. Le fait de délivrer des informations fiscales erronées est donc un manquement aux obligations du contrat conclu entre l’acquéreur et l’agent immobilier. S’il existe un tel contrat en l’espèce, le principe du non-cumul devrait contraindre les acquéreurs à agir contre l’agent immobilier sur un fondement contractuel, à moins qu’ils ne parviennent à obtenir la nullité du contrat conclu avec l’agent immobilier (V. supra, II).
C) Préjudices réparables et obligation à la dette
Les préjudices subis par les acquéreurs sont variables selon que ceux-ci parviennent à obtenir la nullité du contrat de vente ou non.
S’ils ne parviennent pas à obtenir la nullité du contrat de vente, le principal préjudice résidera dans le montant du redressement fiscal.
S’ils parviennent à obtenir la nullité du contrat de vente, les époux auront engagé inutilement des frais de négociation / conclusion du contrat, notamment les 40 000 euros de rémunération de l’agent immobilier (sauf si le contrat duquel découle l’obligation pour les acquéreurs de rémunérer l’agent immobilier est nul, ce qui entraînerait une restitution des sommes versées, V. supra, II).
Il était possible d’envisager, en plus de ces préjudices économiques, l’existence d’un préjudice moral.
En matière délictuelle, le principe est celui de la réparation intégrale. En matière contractuelle, une condition de prévisibilité du dommage s’applique : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » (art. 1231-3.) Cette condition ne s’applique pas en cas de faute lourde ou dolosive, mais un lien de causalité direct entre l’inexécution et le préjudice est alors toujours exigé (art. 1231-4). En l’espèce, les préjudices étaient prévisibles puisque l’agent immobilier comme les vendeurs (présents lors du premier rendez-vous) savaient que les acquéreurs comptaient réaliser une opération de défiscalisation.
Si une faute de l’agent immobilier et une faute des vendeurs ont contribué à la réalisation d’un même préjudice, ils en sont responsables in solidum vis-à-vis des acquéreurs. [La question de la contribution à la dette n’avait pas à être traitée puisque c’est ici la victime qui vient consulter et cette question lui est indifférente.]
N.B. : il n’était pas nécessaire d’envisager la responsabilité du notaire puisque les clients demandaient de ne pas engager la responsabilité du notaire qui est une relation de famille. Il est toutefois envisageable de conseiller au client d’engager la responsabilité du notaire en précisant que celui-ci est assuré, mais il ne pouvait alors s’agir que d’un simple conseil, l’avocat ne pouvant pas engager la responsabilité du notaire au nom de son client si ce dernier lui a expressément demandé de ne pas agir contre le notaire.